vendredi, 17 novembre 2006
cinquante-deux (lorsque l’idiot pointe la lune, le sage serre les fesses)
Sans aller jusqu’à vouloir les passer au peloton d’exécution, j’ai du mal à accepter sereinement que les espèces de neuro-déficients qui viennent raconter bave aux lèvres leur vie minable dans Confessions intimes, par exemple, aient le même droit de vote que moi. Eh ! bien sûr je suis contre la peine de mort, mais aussi pas vraiment pour le suffrage universel direct. Même pour moi je veux dire. Que tout le monde s’exprime par les urnes, c’est bien, c’est essentiel. Mais je m’inquiète du fait qu’à force de ne pas connaître nos institutions, à ne rien biter aux discours et aux intentions de nos dirigeants, à leurs bilans, à ne pas suffisamment faire l’effort de réfléchir intelligemment à la question politique, on en vient à élire non plus celui qui sera le plus talentueux, le plus efficace, le plus légitime, mais le plus populaire. La popularité, c’est du vent… C’est loin quand même d’être un signe de qualité.
On dirait pourtant bien que c’est devenu le nouveau mode de scrutin, celui que tout le monde attendait, celui dans lequel chacun peut se reconnaître et se fondre. Elections Présidentielles ou Star Academy, même combat ! Alors quand une fille, qui se reconnaîtra peut-être, m’envoie un mail pour me proposer de participer à une sorte de concours littéraire sur le net, et même si je suis sincèrement surpris et flatté qu’elle ait pensé à moi, je ne peux que rester perplexe. Au moment même où j’officialise en quelque sorte ma prise de distance d’avec le lectorat, il s’agirait en fait de te demander, à toi qui lis ces lignes, de voter pour ma candidature, afin de lui offrir la chance, que dis-je, le privilège, l’insigne honneur ! d’être examinée par quelques scribes assermentés. Deux notes à peine, et pas des plus enjouées, publiées au mois d’octobre et jusqu’à maintenant, plus de Constance, plus d’histoires de cul, un humour en berne, des jérémiades au contraire à n’en plus finir, un style toujours plus verbeux ; c’est quasiment du suicide textuel. Et malgré tout, je m’en irais, moi, à la chasse au bulletin ? Il me faudrait alors subitement devenir un spécialiste des relations publiques, spammer au maximum tous mes contacts, repeindre les pages de mon journal d’incitations au clic, et faire ainsi ma promo, en clamant à qui veut l’entendre, et avec le sourire encore ! que je suis bien le meilleur ? que c’est moi qu’il faut élire ? Sans oublier bien entendu d’édulcorer généreusement mon propos… Parce que, c’est bien connu, le public – l’électorat - aime la variète. Ce qui est facilement accessible, un peu sucré, un peu rose. Confessions intimes, en somme. Il ne veut rien qui soit amer, le public. Rien qui soit parfois un peu sombre, un peu violent, un peu trop radical. Il veut rire et être heureux. Il veut être diverti.
C’est pas dans le vide de ces pages qu’il va trouver beaucoup matière à divertissement, hein. Et c’est pas pour lui faire plaisir ou gagner je ne sais quel prix formidable que je risque de changer quoi que ce soit. Et pourtant… Oui, bien sûr, il y a un pourtant, et là j’espère que la fille en question aura lu jusqu’ici. Pourtant, donc, je n’écrirais pas une ligne si j’étais mon seul lecteur. Je n’ai cessé de le répéter : ce qui me force, me pousse, me motive à creuser davantage, à labourer ma bile sans cesse, à passer des heures sur mon clavier pour ne finalement publier que le millième de mes mots, c’est l’espoir d’être lu chaque jour un peu plus que le précédent. Le concept du journal intime, cadenassé et caché sous son oreiller, très peu pour moi. Ca ne me soulagerait pas. J’ai besoin d’écrire à tous ce que je ne dis à personne. Besoin de ce cynisme à la Diogène, besoin de me branler généreusement sur la place publique, et que tout le monde en profite. Pardon si ça paraît prétentieux. Mais je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’un désir de reconnaissance ; il me semble au contraire que jamais mon but en ouvrant ce journal n’a été de me faire aimer de tous, ni même de quiconque… j’aurais l’impression justement de faire de la variète. Mais toucher le plus grand nombre, en bien, en mal, en doux ou en amer, et provoquer la réserve ou le dégoût, l’adhésion ou le dédain, oui, cent fois oui. C’est un désir de visibilité que j’exprime. Une volonté d’existence.
Vu comme ça, l’histoire du concours prend tout son sens... Mais non. Je n’y participerai pas. Pourquoi ? Les raisons susdites pèsent déjà lourd dans la balance. Mais c’est sans compter le fait que je suis mauvais perdant… Que l’échec me ferait ruminer pendant des semaines… Que je préfère, en somme, me draper dans une espèce de recul vaguement hautain, et tenter de croire à ma feinte fierté d’indépendant, plutôt que d’affronter le risque, aussi minime, aussi ridicule soit-il, d’une désillusion. Je ne l’ai pas raconté ici jusqu’à présent, mais il y a de cela quelques semaines, je suis tombé sur une occasion, miraculeuse et unique, de quitter mon statut plus que branlant de free lance pour un contrat bien au chaud, dans une petite boîte tout à fait à mon goût. Equipe jeune, visibilité d’un travail que je maîtrise parfaitement, salaire très correct et surtout, stable. Adieu, monde pourri du cinéma ! En enfer, le travail au black, pour les potes, pour des entreprises qui ne paient jamais ! Bonjour, la vie de salarié ! Je m’y voyais déjà. Quand on m’a annoncé que je n’étais pas pris, on m’a juré que ce n’était pas la qualité de mon book qui était en cause... J’ai compris alors que mes craintes d’avoir été médiocre à l’entretien étaient parfaitement justifiées. J’avais raison de croire que je m’étais mal vendu. Pas assez accessible, pas assez sucré, pas assez rose. Pas sympathique. La lucidité était revenue, et au lieu de travailler sur ce point-là, dans cette voie-là, au lieu de creuser les raisons de mon échec, d’essayer de repartir sur de nouvelles bases, de m’améliorer, d’apprendre à aller vers les autres, j’ai eu un geste de dédain, j’ai haussé la tête et je me suis renfrogné de plus belle dans les affres de mon quotidien, jurant en moi-même qu’on ne m’y reprendrait plus à avoir comme ça un peu d’espoir.
Laissons le soleil se lever de lui-même. Bon gré mal gré, et même si c’est de moins en moins rond, le monde tourne, quoi qu’on y fasse. C’est ça mon caractère. C’est ça mon idée, ma seule idée. Moi je resterai dans mon coin, sans faire de vague, sans faire tomber la foudre. Je laisserai les témoins de Confessions intimes voter aux Présidentielles pour le candidat le plus séduisant à leurs yeux bigleux, et les internautes cliquer pour les textes qui auront le plus de verve, de saveur, d’humour, pour les notes les plus sympathiques - et tant pis s’ils oublient que la sympathie est loin d’être une qualité, mais juste la première étape du processus d’enculade. Tant pis pour la visibilité. Tant pis pour les attentes. Je ne prends pas de risque, en restant ainsi à l’écart, n’est-ce pas ? Je suis frileux, peureux peut-être. Quoi ! Ai-je jamais dit autre chose dans ces pages ?
14:09 | Lien permanent | Commentaires (17)
mardi, 31 octobre 2006
cinquante-et-un (six pieds en soi)
Ca commence, tout va bien. On ne pense à rien, ni en bien, ni en mal ; on est, et c’est tout. Par exemple, on se promène au jardin des Plantes, par une belle après-midi, il fait beau, grand soleil chaleureux, plein de monde partout qui profite de l’automne estival : des cris d’enfants, des mères poussant poussettes, des pères heureux, des chiens fous de liberté, qui courent la langue pendante. Et alors, c’est tout à coup comme un souffle très froid qui naît au fond des poumons et remonte dans la gorge, qui pousse sous les yeux, glace les cheveux ; c’est comme une explosion endogène qui cherche à expulser toutes les choses intérieures, du sang et des organes jusqu’aux états d’âme et sentiments, jusqu’au cœur, jusqu’à l’esprit, qui donne envie de dégueuler, qui donne envie de s’écrouler, de s’évanouir, de défaillir, qui donne envie de sortir son revolver et de se le retourner contre la tempe ou même bien au fond dans la gorge, et peng ! de s’exploser le crâne comme une vulgaire coquille. On sent déjà le sang qui coule, on le sent sur la langue, au bout des doigts, on le sent bouillir au creux des veines ; les membres aussi se raidissent, mais le coeur s’emballe, et on se met à accélérer par soubresauts, dans un équilibre instable. Ca paraît assez long, mais c’est sans doute très court en temps réel, quelques secondes, pas plus, et puis ça y est, la mauvaise humeur est installée.
La mauvaise humeur, c’est pas simplement s’être levé du pied gauche et ne pas dire bonjour à sa voisine quand on descend la poubelle, c’est pas simplement une colère sans fondement, une envie de rien faire, de rien aimer ; la mauvaise humeur c’est le reflux brutal de la bile dans tous les organes, dans tous les systèmes, qui tend les nerfs, noue l’estomac, se mêle à la salive comme un venin prêt à cracher, pénètre les veines et torture le cœur, pollue l’âme et les idées, fait disjoncter le sens commun. La mauvaise humeur c’est ce qui explique peut-être qu’on soit si malheureux et depuis si longtemps et sans qu’on n’y comprenne rien, alors que tout va bien, qu’on ne voudrait rien changer, qu’on est content somme toute à sa place, avec son boulot sans avenir et son salaire de misère, qu’on ne saurait pas faire autre chose de toute façon, et qu’on n’a pas l’ambition de participer aux courses folles qui agitent ses semblables. C’est ce pourquoi on se sent toujours plus seul encore en groupe qu’en sa propre compagnie, et malgré ses amis, malgré ses amours, et bien qu’on aime tant les fêtes et les filles et les ivresses, et rigoler, et parler, et vivre en fait ; c’est ce qui fait qu’on est triste et tellement habitué à être triste.
Ma tristesse à moi, je l’accepte et je l’adopte. Elle me convient. Je ne sais pas si les gens savent que je garde ce petit animal en ma cage intérieure, qu’il me tient compagnie depuis tant d’années, qu’il m’est fidèle comme je lui suis fidèle ; mais rien ne semble l’indiquer. Parce que je le cache. Qu’il se tapit, le moche, le pouilleux, le galeux, et qu’il sait que s’il se met à aboyer ou ne serait-ce que geindre en public, c’est la mandale assurée. Ce que j’écris ici et que je lance aux quatre vents, ce léger vertige qui me parcourt encore quand je rêvasse à ma fenêtre ou quand arrive le métro, et qui se met à bouillir d’émotion quand les bonheurs comme les malheurs sont trop intenses, ou même parfois pour rien, par surprise, comme au Jardin des Plantes, je n’en fais part à personne. Parce que c’est trop effrayant, que c’est trop puéril, trop ridicule. Ce n’est pas digne d’une grande personne, d’avoir son mauvais feu à soi, pas conforme à l’image d’adulte raisonnable et sage, et serein ! que je cherche à offrir aux autres et à moi-même. Voilà pourquoi je n’arrive décidément pas à ouvrir mon cœur à quiconque : ce serait comme cracher à la gueule de quelqu’un après avoir croqué dans une tablette de chocolat. Bien amer… Mais qu’elle disparaisse, ma tristesse, qu’on me l’enlève, mon malheur, et je ne saurais plus qui je suis.
***
On l’aura compris, ces pages me serviront désormais plus à déverser mon trop-plein de fiel, de bile, de mauvaise humeur, qu’à débattre d’idées profondes et réfléchies avec des lecteurs qui sont pourtant de plus en plus nombreux, malgré la distance que j’ai prise avec eux, et qui bizarrement ne semblent pas encore s’être lassés de mon sale caractère. C’est un peu dommage de laisser tomber cette part essentielle du concept de journal moderne, d’abandonner lâchement l’idée d’échange, de partage, mais d’une part je n’en ai plus ni le temps ni l’envie - oui, je me répète -, et d’autre part il est clair que ça va me permettre de m’affranchir d’un poids bien encombrant, de cette sorte d’autorité morale que constitue le jury du lectorat, de me débrider, de m’élever peut-être, de dire enfin ce que je veux, quand je veux, sans craindre de plaire moins. J’ai conscience de m’être quelque peu radicalisé. Je sais bien que mes notes se sont même sévèrement alourdies, à quel point elles sont empesées, ampoulées.
Je me souviens aussi avoir commencé ce journal en disant que seule comptait la narration, et qu’on verrait ce qu’il ressort, ou pas, du reste ; je me souviens avoir écrit qu’il importait peu de savoir qui je suis. C’est une erreur, que j’ai comprise assez vite, et je pense désormais le contraire exactement. Rien ne m’insupporte tant aujourd’hui que de raconter une anecdote à la con sur cinq mille signes, dans le but unique de travailler mon style, de ciseler mes phrases comme on taille un bout de bois, et de recueillir des compliments enjoués sur ma plume. Tout ça, j’en n’ai rien à foutre. Là par exemple, je sors d’une histoire de téléphone et de taxi qui s’avérait pas mal, il y avait un bon thème d’attaque, du suspense, une pincée de surnaturel et une bonne dose de romance ; c’est malheureusement assez vite parti en eau de boudin. J’ai eu beau tenter de pimenter la narration à grands coups de formules de style bien trouvées, de vocabulaire abscons, de ruptures de rythme, rien n’y faisait, et c’était long, c’était plat, c’était mou. Un long torchon qui s’étirait sur quatre pages et dont on ne pouvait tirer qu’un jus douteux. De la soupe. Du flan.
C'est terminé. J’ai troqué ma plume contre ma pelle et ma pioche.
18:25 | Lien permanent | Commentaires (11)
lundi, 02 octobre 2006
cinquante (qui-vive)
On regardait le journal télévisé hier soir chez mon ami ***. Lui aussi adore la téloche et admire comme moi son art de montrer sans concession la bêtise hallucinante des gens qui nous entourent, la misère profonde, l’absurdité totale, l’échec même de toute forme de société, d’existence, d’humanité. On a vu par exemple cette ville du Nord de l’Angleterre, dont les caméras de surveillance des rues se doublent désormais d’une voix (en réalité, un agent de police derrière ses écrans de contrôle) qui rappelle à l’ordre le méchant contrevenant. Tu jettes un papier par terre ? « Le monsieur en gris, là, vous êtes prié de ramasser ce déchet ». Tu te promènes une bière à la main ? Le doigt de dieu se pointe sur toi. On ne pourra bientôt plus traverser en dehors des clous. On n’aura plus le droit de mettre un pull bleu avec un pantalon noir. Big Brother is now talking to you… Même réaction pour nous deux, donc, face à l’annonce par la journaliste que le reportage qui suivait pourrait heurter les plus sensibles par ses images choquantes : une satisfaction bruyamment appuyée qui en dit long sur notre situation de jeunes occidentaux décérébrés, oisifs, avides de spectacles sanglants. A moins que ce ne soit qu’un moyen de prendre du recul face à la gravité des choses ? De « rire de tout de peur de devoir en pleurer » ? Toujours est-il qu’on en a eu pour notre compte. C’était les émeutes en Palestine, ou plutôt, dans la bande de Gaza, on voyait des hordes de furieux manifester en hurlant, kalachnikov en bandoulière ; et puis ça a dû dégénérer, des types se sont mis à tirer dans tous les sens, jusqu’à ce moment où, en embuscade au coin d’une rue, l’un d’entre eux se découvre un instant et peng ! se mange une balle, une seule balle en pleine tête, qui lui coupe le sifflet, le souffle et lui siffle la vie. Par terre le bonhomme, aussi mort que mort.
Là, on aurait bien voulu rigoler mais c’est la surprise qui a pris le dessus. C’est pas tous les jours qu’on voit un type, même à travers un écran, se faire flinguer en direct. Vivant / mort. Pour de vrai. Quelle idée lui est venue de se lever ce matin ? Pourquoi n’est-il pas tranquillement resté chez lui à ne rien foutre, comme je le fais, pourquoi ne pas s’être tenu à l’écart de toute cette agitation, de toute cette folie qui pousse jusqu’aux portes et parvient même parfois à pénétrer chez les gens ? Qu’est-ce qui a valu qu’il offre ainsi sa carcasse à la guerre, celle des hommes d’abord, et celles des images de surcroît ? Voilà à quoi mène l’investissement dans les rapports aux autres. Voilà ce qui arrive quand on commence à prendre au sérieux les affaires des hommes, quand on se met à attacher de l’importance à des notions aussi primaires et vaines que celles de territoire, de pouvoir, de dieux.
Je ne me lie à rien, je n’aime personne pour ces raisons précises. Mon credo, observer, décrire, analyser ce qui m’entoure, avec un pied en retrait, sur le qui-vive, toujours prêt à ramasser mes affaires et filer en dix minutes montre en main si jamais toute cette animation furieuse et vide de sens se met à vouloir me tomber sur le dos à moi aussi. Parce qu’elle n’attend que ça. Elle sait se faire discrète et rôder, la vicieuse, guetter le moindre instant d’inattention, le plus petit relâchement, et voilà, on se retrouve à se la donner en société parce qu’on est allé au Ritz, par exemple, ou à saliver devant des costumes à quatre chiffres, à étaler sa science misérable pour épater une galerie non moins méprisable. Ca m’arrive à moi aussi d’y croire, à la vie. A me dire que c’est sérieux. A espérer des choses, à en regretter d’autres, à penser que de les faire de telle ou telle manière pourra avoir de l’importance. Quand je tombe amoureux, moi aussi je sais que c’est pour toujours, qu’on est les seuls à s’être jamais aimés aussi fort. Les échecs, qu’ils soient sentimentaux, professionnels, m’atteignent et me meurtrissent encore profondément, comme s’ils pouvaient avoir une quelconque incidence sur la suite des événements, comme s’ils allaient empêcher le soleil de se lever le lendemain. Il y a même une époque où, en situation plus ou moins aussi précaire qu’aujourd’hui, je me souciais des problèmes d’argent en fin de mois, quand, poursuivi par la banque, on me donnait un délai de deux semaines pour combler un découvert ; je m’inquiétais, je m’énervais, je perdais mes moyens, et puis deux semaines plus tard le découvert était comblé comme par miracle, parce qu’on trouve toujours une solution à tout, parce que tout s’arrange toujours, parce que rien n’a d’importance quand on sait rester calme et en retrait. Les problèmes de gens se règlent aussi facilement que les problèmes d’argent, et s’oublient, s’estompent, s’évanouissent avec le temps. Alors, à défaut de bonheur, on trouve au moins le repos, le silence, la sérénité ; on dépasse la conscience pour accéder à la surconscience.
La surconscience, c’est justement le fait de réussir à toujours poster son regard non seulement au-dessus des autres et de ce qui les anime, mais de soi-même également, et de se voir évoluer, marcher, parler, rire ou faire l’amour, aller au supermarché, prendre le métro, des taxis, téléphoner ; c’est se voir écrire son journal, espérer bêtement que son billet plaira, qu’il sera vivement commenté ; c’est contempler le pantin en chiffon de son enveloppe corporelle et se dire qu’il est parfois, souvent, toujours bien ridicule. C’est tenter par tous les moyens de s’arracher à cette enveloppe et de s’élever par l’esprit, avec distance, avec critique, mais c’est avoir compris aussi que même l’esprit ne vaut rien, et que ce qui retourne à la terre, à la fin, c’est bien cette carcasse et rien d’autre, qui une fois plantée là donnera peut-être un arbre, une fleur ou un peu d’herbes folles. Tu l’auras ta réincarnation, mon vieux militant mort au JT, mais sans doute pas celle que tu crois, et certainement pas de paradis ni de dieu ni de vierge, avec un peu de chance si tu te décomposes correctement tu vas nous pondre un joli pissenlit, et c’est ainsi que la vie continuera, et tu auras trouvé le meilleur moyen, je te le dis moi, de faire tourner le monde.
On me reproche souvent de ne pas vouloir m’investir dans les rapports aux autres, de rester toujours critique à l’égard de mes amis, distant avec mes femmes, méfiant vis-à-vis des relations nouvelles. Pardon de ne pas sauter au cou de mon nouveau voisin, pardon de ne pas l’aider sur-le-champ à monter ses cartons, à emménager son appartement, et pardon de ne pas être cordial avec cette dame, pourtant fort sympathique, qui m’adresse – fait exceptionnel – la parole dans le métro. Pardon si les amis de mes amis ne sont pas mes amis, si les liaisons virtuelles me semblent sans espoir et sans avenir, s’il me paraît improbable de faire des connaissances durables en soirée, ou au travail, ou dans la rue. Je voudrais bien, moi, savoir me lier facilement, simplement, spontanément à mon prochain, je ne demande même que ça, de l’aimer, de partager sa route, ses envies, ses loisirs et ses préoccupations, même pour quelques temps, pour un instant seulement ; je voudrais bien savoir me fondre avec lui dans une foule intense, manifester sous les mêmes banderoles, sous les mêmes bannières et sous le même mot d’ordre, et me sentir enfin partie d’un tout. J’y arrive aussi, parfois, au cours d’une soirée ou d’une nuit bien arrosée, comme avec ces deux filles, ces chères renardes rencontrées lors d’un mariage en Bourgogne, l’été dernier ; mais lorsque pointe le matin, et qu’on est dégrisé, et qu’on a atterri, on ne lit plus sur les visages et dans les yeux, à la lumière du jour, qu’un discours qu’on ne peut déchiffrer, qu’on ne peut comprendre, auquel on n’adhère plus. Alors il ne reste plus qu’à dire adieu à sa compagne d’une nuit, à se désolidariser de ses rencontres de la veille ; on ne partagera plus le même oreiller, ni les mêmes goûts, ni les mêmes attentes, ni plus rien à vrai dire, on se croisera peut-être au supermarché, on prendra les mêmes métros et on regardera les mêmes chaînes de télévision, mais on part chacun de son côté en espérant entendre enfin le cœur parler.
Cette note, suite à un petit pari, devait concerner la Rue de Beaune, journal de la fille emmêlée. J’avais préparé des choses, mené mon enquête, lancé quelques pistes. Je n’ai rien pu en tirer de bon. Il me semble que le désengagement de ma parole, même s’il n’a rien à voir avec ce que je lis d’elle ou ce que je sais d’elle, n’en illustre que mieux ce que je viens de dire.
18:40 | Lien permanent | Commentaires (22)
dimanche, 24 septembre 2006
quarante-neuf (les fausses routes)
C’est dommage, la journée avait vraiment bien commencé. Après une très bonne soirée hier (ah, mais toute la journée de vendredi fut bonne, j’ai bouclé un travail en moins de temps qu’il n’en faut pour le taper sur le clavier) et une excellente nuit passée à cuver vaillament mon vin, j’ai été réveillé par les chauds rayons de soleil qui baignaient la capitale. Je me suis levé, l’esprit vierge de tout programme, à part celui de rentrer chez moi prendre une douche et manger un morceau - oui, j’ai dormi ailleurs, mais seul, n’est-ce pas. Croque-monsieur parfaitement réussi, accompagné d’une verte et fraîche salade. C’est que j’ai décidé de manger équilibré et de tenter de perdre les deux insupportables kilos qui se sont tranquillement installés, vermines, parasites, lors de mon inactivité estivale. Afin de retrouver mon corps d’athlète de seconde zone, la quantité, pantagruélique certes, de fromage que j’ai l’habitude d’enfourner entre les tranches de pain et de jambon s’est ainsi tragiquement vue réduite à la portion congrue. Tiens, je pense à l’instant que je n’ai plus de balance, puisque je me servais de celle de Constance et que la petite nous a quitté jeudi dernier pour sa province nouvelle. Plus de maîtresse ni de balance, il va falloir chercher ailleurs la motivation pour maigrir.
J’avais d’ailleurs pris rendez-vous par la suite à 17h30 devant l’Opéra Garnier, et je pensais y aller à pieds ; au bout de dix minutes de marche, je me suis engouffré avec bonheur dans une bouche de métro. Bref, c’est pas gagné... En sortant, je suis par malchance tombé en plein milieu d’une manifestation aux motivations pas très claires. En gros, il y avait des drapeaux du Liban et de la Syrie, des barbus, des femmes voilées, mais aussi des formations « gays et lesbiennes contre la guerre », des bobos à poussettes descendus de Montmartre, des bannières en Hébreu, et bien sûr la cohorte habituelle des pique-revendications, ceux qui mangent à tous les râteliers manifestants du moment que ça gueule bien, que ça peut cracher par-terre et sur les flics, verbalement du moins, en toute impunité, et que ça croit faire la révolution prolétarienne : j’ai nommé les marxistes-léninistes, les drapeaux noirs, la CNT, j’en passe et des meilleures. Ici et là, des portraits des leaders terroristes moyen-orientaux, exactement ceux qu’on ne croyait pouvoir apercevoir qu’à la télévision, le soir vers vingt heures. Un moment, une femme qui aurait pu être ma boulangère s’est mise à hurler « vive le Hezbollah » comme une harpie dont on déchire les entrailles. Une drôle d’impression. Plus loin, une sorte de camionnette aménagée en tribune s’est installée devant l’Opéra : s’y succédaient plusieurs personnages discourant dans un micro, et se contredisant bien involontairement les uns les autres, quand ce n’était pas le même orateur qui disait oui en disant non. Ca m’a rappelé le mea culpa de Zidane en juillet dernier, qui affirmait regretter son geste malheureux contre Materrazzi mais qui, ça va de soi, n’aurait rien changé si c’était à refaire. Merci Zinedine, t’as tout bon. Mais le plus curieux dans cette histoire de manifestation, c’est que j’ai eu beau demander à tous les acteurs du drame, du simple porteur de drapeau au barbu le plus farouche, en passant par le policeman au coin de la rue, à bonne distance, personne n’a su m’informer sur les tenants et les aboutissants de l’événement. On en restera là, quoi que je serais curieux de savoir ce que vont en rapporter nos amis les médias.
Comment j’ai pu retrouver, dans cette inextricable cohue, les deux personnes avec qui j’avais pris rendez-vous, demeure un épais mystère. Toujours est-il que nous avons fui au plus vite, et que pour changer radicalement l’ambiance, nous avons filé au Ritz, à deux pas. On aurait pas pu trouver mieux. Un endroit qui, quoi qu’on en pense, ne fait pas de discrimination, c’est bien le vénérable établissement. Malgré ses ors, ses tapis rouges, sa porte tournante et son personnel tiré à quatre épingles, on peut y rentrer sans problème, ni remarque, ni le moindre regard de travers, aussi mal rasé que je l’étais aujourd’hui - et en baskets pourries, encore. En fait, sa sélection, le Ritz ne la fait que par l’argent. Quelle révélation, n’est-ce pas. Bon enfin moi personnellement je m’en cogne, puisqu’on avait l’amabilité de m’inviter, et qu’on est plus riche que moi de quelques millions. J’avais donc le droit de prendre place dans le jardin de derrière, fort agréable ma foi, d’où s’élançaient quelques notes de harpes – comment ça une vraie harpiste, bien évidemment - qui semblait régler délicatement le ballet des serveurs ; et je dois d’ailleurs préciser que je n’étais pas celui qui dénotait le plus. On a pu distinguer deux jeunes Américaines en slim et Ray Ban, qui attaquaient rageusement leurs assiettes tout en hurlant dans leurs téléphones portables. Elles sont heureusement parties assez vite. Un peu à l’écart, il y avait un type en blazer bleu, couronne de cheveux, nez oriental, avec une gueule qui me disait quelque chose ; il sortait sa poule et lui faisait boire du champagne à six heures de l’après-midi. Quand on imagine seulement le prix de la bouteille (les plus chères atteignent les cinq mille euros, tout de même), on en viendrait presque à lui souhaiter qu’il fasse un bon investissement sur l’avenir. Je m’en souviendrai la prochaine fois que je devrai en mettre plein la vue à une fille, en espérant bien sûr qu’elle ne se mette pas à commander cinquante grammes de Beluga... En tout cas, naviguer entre deux mondes si différents, opposés, presque adversaires, qui se font face à cent mètres l’un de l’autre, ça fiche un drôle de mal de mer. Je ne connais ni l’un ni l’autre, je n’appartiens ni à l’un ni à l’autre et aucun ne pourrait me convenir ; je ne sais pas où aller et à vrai dire, je ne sais décidément pas où je vais.
Bon, je sors de là, le voiturier m’avance ma Bentley mais je vais préférer la marche. Ah, on me fait signe que non, la Bentley n’était pas pour moi ; ça tombe bien alors. Comme à l’allée, je finis le trajet en métro. A l’arrivée, il pleut. Il fait presque nuit. J’envisage de me faire un petit plat de sale perso, avec du vin et un film dans mon fauteuil, mais la nouveauté c’est que mon lecteur DVD ne marche plus. Pas envie de sortir ; du coup, ce billet se pond presque tout seul. Lui non plus n’était pas prévu. Ni réfléchi d’ailleurs, ni travaillé, ou encore de grande qualité. A propos, je crois que ce qui va se passer désormais sur ces pages, c’est qu’il s’y publiera de temps en temps une note écrite un soir d’ennui, de désoeuvrement, de solitude, ou plutôt un soir où je sentirais le besoin de taper sur un clavier ; parce que si j’écrivais à chaque moment de solitude, de désoeuvrement ou d’ennui, on ne serait pas sorti de l’auberge. Peut-être sera-ce toutes les semaines, ou deux fois par mois, ou moins encore. Je tente cette méthode, puisque celle de l’effort et du labeur n’a pas été payante sur le long terme, à mon grand regret. Et oui, c’est comme un forfait qu’on déclare. Un aveu de faiblesse, en somme. C’est difficile de ne jamais réussir à choisir ses qualités. Celles grâces auxquelles on décide de se construire. Je me rêve en homme fort et tenace, stoïque, je m’efforce à toujours réfléchir, prendre du recul, mettre en balance, je me lance dans de vains combats, contre les kilos superflus par exemple, et je finis comme toujours par me vautrer dans la facilité, l’accessible, le connu. Mais le vrai luxe, c’est ça : la tranquillité. Qu’il s’agisse de payer vingt-cinq euros son mojito pour échapper aux réalités d’un monde qui gronde juste derrière la porte tournante, ou se soustraire à ses obligations de réflection, d’analyse, parce qu’on est paresseux, qu’on préfère se saborder que de continuer, on en revient toujours au même souhait : celui de ne pas être dérangé.
Je me demande si j’ai déjà, au cours de ma trentenaire existence, fait le moindre choix, ou si au contraire tout ne s’est pas imposé à moi parce que je suis paresseux et que je prends toujours la voie la plus praticable, la moins fatigante, la moins dangereuse. Tu parles d’un luxe. Les choses viennent à moi, ou pas, amis de circonstance, rencontrés par hasard et accompagnés par concordance des temps plus que des sentiments, carrière aléatoire qui s’est décidée toute seule et souvent contre mon gré, femmes auxquelles je m’attache parce qu’elles ne me rejettent pas, et jusqu’à cette note écrite parce que mon lecteur DVD a rendu l’âme. J’ai beau dire je, j’ai beau dire moi, c’est parfois à se demander s’il n’y a pas quelqu’un derrière qui tient la plume à ma place.
03:00 | Lien permanent | Commentaires (18)
mercredi, 13 septembre 2006
quarante-huit (en pleine tête)
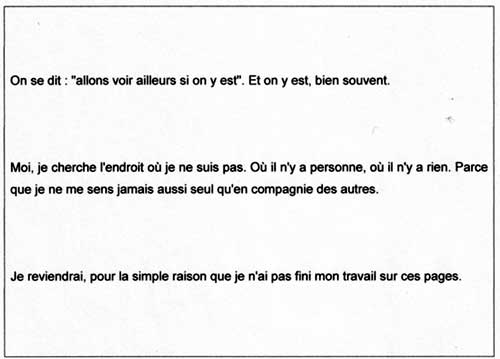
16:35 | Lien permanent | Commentaires (23)
mercredi, 06 septembre 2006
quarante-sept (le bonheur pour 100 millions de dollars)
On a beau tenter de se limiter à des plaisirs simples, accessibles, raisonnables, on a beau se forcer à être fataliste, et accepter la médiocrité, et se résoudre à un sort pourtant peu enviable, on en veut finalement toujours plus, ou mieux, ou différent : c’est ainsi. Sans vouloir généraliser et aller jusqu’à parler de propre de l’Homme, il est facile de constater que ce sentiment absurde reste étranger à nos chers amis les animaux : un chat qui mange en une fois la totalité de ses croquettes, en vidant sa gamelle avant de trouver la réserve et d’y tout rafler, ça s’est vu, mais c’est rare. Et puis ce n’est, selon moi, qu'une dégénérescence due au voisinage des bipèdes - en général, une fois rassasiées, les bêtes ne pêchent pas par gourmandise. A part ces cupides écureuils, ou cette insupportable moraliste de fourmi, elles ne cherchent jamais à amasser, qu’il s’agisse de nourriture, de territoire, ou de conquêtes sexuelles. Mais quand moi, qui ne suis qu’un homme, je cherche tranquillement, modestement, petitement, des recharges de polaroïd sur un célèbre site d’enchères en ligne dont le nom commence par « e » et finit par « bay », je tombe d’abord sur un super appareil bien plus élaboré que le mien, qui me fait instantanément envie, et j’ai ensuite le malheur de découvrir les autres objets du vendeur… Entre un « circuit Hornby » (mais qu’est-ce que c’est que ce truc ?) à mille euros tout de même, et un « moulin à poivre géant » (!) à trente-cinq, ceci :

Tête de jeune fille à la frange, Modigliani. Alors c’est simple, il me la faut. 13 500 euros, ça se trouve facilement, non ? Non ? Même si j’ai déjà un apport de disons… mille euros ? Toujours pas. Même à la banque – surtout à la banque. Bon. Je pourrais contacter un organisme de crédit, en six minutes j’aurais ma réponse, paraît-il. Mais il semblerait également que ce genre de privilège fallacieux ne soit accordé qu’à une clientèle déjà largement surendettée désireuse d’acheter des home cinémas. Un coup marketing, je crois que ça s’appelle. Une sorte d’alliance des puissants, mais allez, je m’égare. Vendre un truc en échange, alors ? Oui, un truc de valeur. Genre ce que j’ai de plus précieux. (Rapide tour d’horizon de mon environnement.) Je pourrais déjà tirer près de 250 euros de mon ordinateur. Mazette ! Et 25 euros de mon scanner - peut-être trente. Ah ! j’avais pas regardé dans mon placard : on peut rajouter deux costumes et deux paires de groles de marque italienne. Grandes marques italiennes. Enfin il faudrait assumer d’aller à mes rendez-vous, certes peu nombreux en ce moment mais raison de plus, en jean et en basket. Après… Vendre des livres (de poche) ? des disques (gravés) ? Mon corps (...) ? A la rue, ou même à la science ? J’y ai pensé ! Mais je ne suis pas sûr que ce que j’en tirerais en vaudra la peine.
Sans rire, je me suis toujours dit que quand je serai grand, et riche, et enfin posé, je m’achèterais une toile de maître à placer au-dessus de ma cheminée, dans mon salon ou dans ma chambre. Un Bruegel, par exemple - l’Ancien, oui. Un Ucello, que j'aurais acheté au Louvre. Un Picasso, ou un autre, ou bien celui-ci. Ou encore Chagall, Raphaël, Bosch. Je le contemplerais longuement, mon chef-d’oeuvre, en silence, sans être capable de ne rien faire, et je me dirais que ma vie a eu un sens puisqu’elle m’aura offert de me repaître les yeux de ces merveilles. Parce que je crois que je ne pourrais jamais m’en rassasier. Jamais m’en lasser. Parce que jamais je ne pourrais désirer plus, ou mieux, ou différent, et parce que plus, ou mieux, ou différent ça n’existera plus. On comprend ce que signifie l’échec des mots, et j’irai même jusqu’à dire, de l’image animée, finie, face à ces visions pérennes et plus mouvantes qu’il n’y paraît. Combien d’interprétations pour un seul coup de pinceau ? Quels sont les mondes inexplorés qui s’ouvrent au creux de ces couleurs et de ces courbes ? Combien d’heures de lecture, combien de philosophies, de théories, de vers et de rimes, et ces mille histoires qu’on se laisse conter, et cet œil qui passe du bleu au vert, du jaune au rouge, et cette bouche qui parle une langue inconnue et ces corps alanguis qui n’expriment que les mystères et les puissances de l’univers… Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? Oh, trois fois rien, ma toile de maître et je pourrais mourir en paix.
Dès lors, deux stratégies de bonheur s’affrontent. D’abord, celle que j’ai décrite plus haut, dite des « plaisirs simples ». C’est l’amour raisonnable que j’évoquais dernièrement, qui consiste à se satisfaire de celle qu’on a trouvée là, sur sa route, qui a souri et proposé de continuer ensemble, parce qu’à deux c’est plus facile qu’à un. Pourquoi se poser des questions ? Elle est belle et pleine de qualités. Quant au sentiment amoureux, on verra bien s'il finit par venir. C’est, aussi, se contenter de son studio perché, sans confort mais avec tant de charme ! enfin ça c’est ce qu’on se dit. C’est accepter de ne pas évoluer dans son travail, depuis trop longtemps et peut-être pour toujours, mais se dire que c’est suffisant, que c’est très bien comme ça. De toute manière on n’a pas l’intention de nourrir qui que ce soit, à part son aigreur de petit vieux et sa misanthropie croissante. Ca fait quelques années que j’essaie de raisonner comme ça, en cherchant la voie de la sagesse. J’aimerais bien être sage, pas « sage comme une image », s’entend, mais réfléchi, sensé, avisé. Pas blasé, pas revenu de tout, mais avec le recul de l‘expérience, pouvoir se dire : je suis heureux malgré tout. Ce sont des qualités qui m’ont souvent fait défaut mais que je crois qu’il est possible d’acquérir.
Et puis, il y a la stratégie qui consiste à chercher la qualité suprême dans le bonheur, à viser l’indépassable, le sublime, l’extase permanente, parce qu’autrement, comme je le disais, on est toujours tenté par la surenchère, et qu’avoir le meilleur est le seul moyen de ne pas rêver à mieux. Ne pas se contenter de la deuxième place dans la course à la vie, derrière son possible, derrière l’ombre de soi-même. L’argent ne fait pas le bonheur, mais l’or… Reste à savoir lequel de ces deux sentiers du bonheur rend finalement le plus malheureux : mais s’il est dur de se dire qu’on n’aura jamais, quoi de plus cruel que de penser qu’on aurait pu ? Bon, sur ce, j’y retourne : il ne me reste plus que trois jours pour trouver mes 13 500 euros.
16:00 | Lien permanent | Commentaires (43)
jeudi, 31 août 2006
quarante-six (la douleur)
C’est trop dur ! J’abandonne. Je n’y arrive pas, je n’y arrive plus et n’y suis même jamais arrivé. Il y en a pour qui c’est facile, pour qui c’est naturel d’écrire, et même pour qui c’est un besoin, les phrases leur jaillissent sous les doigts, ils ont dix idées par secondes, la frénésie les habite ; pour ma part c’est une difficulté perpétuelle et croissante, une souffrance continue, un douloureux et permanent déchirement. Et mes notes se rédigent de moins en moins vite, parce que je ne trouve pas mes mots, et j’en suis rarement satisfait, parce que je n’en trouve pas le sens, et que c’est lourd, que c’est long, et je peine, et je lutte sur mon clavier. Le plaisir de la publication, indéniable mais ponctuel, occasionnel, ne parvient jamais à compenser la panique permanente de la page blanche, ou pire, noircie d’inepties absconses et sans fond. Des choses, oui, j’en ai à raconter. Au sujet de Constance, par exemple, qui me filait entre les doigts, qui m’a annoncé son départ pour six mois, à Lyon, et avec qui j’ai baisé en pleine rue, lundi soir, dans un étrange élan ressenti pour ma part comme une sorte d’amour raisonnable. Un peu comme de penser : « ce n’est pas la passion, mais l’attachement suffira ». Je pourrais réfléchir à tout ça. J’ai essayé. Je n’y parviens plus.
J’ai cru un moment que tenir son journal était comme se regarder dans un miroir : on s’inspecte soi-même, on surveille si tout va bien, et se découvrir un épi permet de se remettre la mèche en place. Parfois, au contraire, on se lance une grimace, parce qu’on se trouve beau, parce qu’on se trouve moche, parce qu’on a juste envie de rigoler. J’ai cru que ce serait aussi facile que ça. Mais c’était sans compter qu’en ce qui me concerne, et je l’ai déjà dit, le miroir m’hypnotise complètement. Je peux rester longtemps planté là sans rien dire, à observer, à regarder ma gueule tordue, à détailler la barbe que je n’avais pas quand j’étais enfant, et que je ne pouvais imaginer, à me reconnaître un instant sous les traits de l’enfant que j’étais, et puis finalement non, finalement plus ; à me demander si c’est bien moi là-devant, en face ; à ne pas en revenir. Un peu comme s’il m’arrivait de me voir en rêve, en narrateur omniscient, ce qui n’est jamais le cas : dans les rêves, j’agis comme dans la vie réelle, de mon seul point de vue, toujours. Mon journal, j’en suis le premier lecteur, et comme face à mon miroir, j’en deviens peu à peu le simple spectateur ; parce qu’il est tellement fatigant de le faire vivre, ce journal, de le vivre, tout simplement, et aussi, parce qu’il est donc si angoissant de se dire que c’est soi-même qu’on a sous les yeux.
A ce propos, j’ai constaté ici dernièrement quelque chose qui m’a beaucoup surpris. Je m’explique. Au rattrapage du bac, en philo, l’examinatrice, pensant me faire une faveur, m’a donné comme sujet la question « qui suis-je ». J’ai passé les dix minutes de préparation à suer sang et eau, sans pouvoir penser à rien, l’esprit complètement submergé par la peur de mal faire, avant de déballer à une prof atterrée trois minutes trente de niaiseries sans queue ni tête. « Ca vaut zéro », fut son unique commentaire. J’ai finalement décroché le diplôme grâce à mon improbable performance en histoire, mais depuis, je pense souvent qu’à la question « qui suis-je », je vaux zéro. Cette épineuse problématique, qu’à défaut de divan j’essaie tant bien que mal de coucher sur mes pages, avait jusqu’alors l’habitude de prendre différentes formes, de se manifester subrepticement au cours des notes les plus variées, sans qu’on s’en rende compte, comme un leitmotiv, comme une idée fixe aussi. Découlait d’elle des litanies de « pourquoi », de « comment », de « mais enfin » et d’ « ou alors » auxquels je ne comprenais rien : à force, on finissait par s’y perdre, et par ne plus savoir ce qu’on était venu chercher ici. Et puis, au fil des échanges avec des lecteurs qui ne sauront jamais à quel point ils me motivent pour continuer, et que de ce fait je ne remercierai jamais assez, la question s’est muée peu à peu pour se retrouver finalement tronquée en simple mais non moins inquiétant « suis-je ». Visionary old Bill… Pour moi, c’est un peu vexant, évidemment, voire assez dur. Mais à bien y réfléchir, il est tout à fait légitime que l’avertissement de ce journal, sa première note qu’on découvre encore malgré son ancienneté, en déroutent certains. Un personnage de fiction, c’est quelqu’un qui n’existe pas, tout simplement. On veut bien lire ses histoires, suivre son quotidien, l’écouter parler indéfiniment de sa Constance inerte et de son inertie constante ; de là à participer à ses débats, donner son opinion sur ses choix de vie, ses relations, ses activités… c’est un peu comme pisser dans un violon : ça ne sert à rien. On n’arrête pas les nuages en construisant un bateau, comme disait l’autre.
Mais j’existe bel et bien, et cette souffrance, cette difficulté d’écrire, et ma volonté d’avancer malgré tout, en sont la preuve. On ne se sent jamais tant exister que dans la contrainte et dans l’effort. Si c’était un plaisir, un passe-temps, un moment de détente dans lequel je me vautrais paresseusement, si j’avais l’imagination galopante, la verve du narrateur, je pense que ce journal ne dirait pas ce qu’il a à dire, n’aurait pas la valeur que je cherche à lui donner, et qu’on pourrait alors légitimement s’en méfier, mettre en doute son contenu. Mais pas de doute. Mossian, c’est moi, et quand je relis mes mots je retrouve ceux de mon enfance, vieillis, torturés comme les traits de mon visage qui se reflètent sur mon miroir, et je vois les marques de ma douleur et je repense à ma peine ; Mossian, c’est moi mais c'est ce moi qui reste encore à définir. Il n’est pas question d’arrêter maintenant de noircir des pages, ni même de prendre une pause ; simplement, j’avais hâte d’en avoir terminé avec cette note.
Je suis vidé mais mon plaisir est intense.
04:00 | Lien permanent | Commentaires (40)
vendredi, 25 août 2006
quarante-cinq (en rond)
Bon, c’est la fin des vacances, non ? La rentrée, même. Pas trop tôt. Je lisais l’autre jour l’interview de Vincent Mc Doom dans Voici : le journaliste lui affirmait que cette période était propice aux bilans. Ca ne m’avait jamais effleuré mais je trouve ça très juste, très pertinent. Finalement, on peut trouver du bon dans chaque lecture, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit je pressentais depuis un moment qu’avec le mois d’août finirait une période d’insouciance et de paresse, faite d’horaires décalés, saccadés, torturés, d’asociabilité croissante et pathogène, et d’un vide culturel et intellectuel qui commençait véritablement à poser problème. On pourra dire sans se tromper que cet été, à part plusieurs longs week ends ou mariages passés en dehors de Paris, et quelques jours disséminés de ci de là, au cours du mois d’août, entre la côte atlantique et la frontière belge, je n’aurais pas fait grand-chose. J’en arrivais même à sauter des repas, par flemme. C'est dire si, pour moi comme pour Vincent Mc Doom, il est grand temps de faire le point.
D’autant que Constance est rentrée avant-hier, mardi. J’ai reçu un coup de fil en fin d’après-midi, alors qu’elle débarquait gare de Lyon. Au téléphone, elle restait un peu muette comme à son habitude ; je lui ai proposé de la rejoindre chez elle, et de lui préparer un petit repas bien brûlé comme moi seul en ai le secret. « A moins que tu ne préfères qu’on sorte dîner ? – Comme tu veux… » Les retrouvailles furent curieuses, on ne savait pas trop quoi se dire et chacun regardait ses pompes en souriant bêtement. Sa peau a bronzé, par endroits, avec des marques de maillot partout et des coups de soleil sur le reste. Ses cheveux, ses sourcils ont visiblement éclairci. On lui découvre des tâches de rousseur délicieuses sur le haut de la poitrine, les épaules et le dos. Elle ramène des yeux très bleus, tellement plus foncés que d’habitude ; on y voit la fatigue d’avoir beaucoup ri. Elle a l’air… changée. « Tu crois ? » Je sais de quoi je parle : plus d’un mois qu’on ne s’est pas vu. C’est ainsi, Constance peut parfois disparaître des semaines ou des mois entiers, sans donner de nouvelles, répondant à peine à son téléphone. Il ne faut pas s’en inquiéter, et pour ma part, j’ai cessé d’espérer découvrir un jour tout ce qui lui passe par la tête. Et puis un beau matin, de manière aussi impromptue qu’elle s’était éclipsée, elle revient, comme si de rien n’était. Elle fait « salut » dans un demi-sourire, la tête inclinée, et attend qu’on lui parle. Au début c’est déroutant, mais on s’y fait très vite.
On a mangé chez elle une tarte jambon-courgettes, préparée du mieux que j’ai pu, c’est-à-dire plutôt mal. Assez vite, on en est venu à parler du type qu’elle a rencontré, chez ses amis, au sud de Toulouse, et avec qui elle m’avait avoué avoir couché. Un petit dérapage, comme le mien j'imagine. L’alcool, sans doute, le soleil, la piscine. C’est excusable. Tu parles ! j’ai failli avaler de travers. Alors c’est bien simple : ma belle a passé trois jours et quatre nuits accrochée à un type que je ne connais même pas, qui s’appelle Thomas comme moi, en plus, et qui a eu tout le loisir de la baiser tranquille dans tous les sens avant de repartir vers sa chère ville de Marseille. Bonnes vacances mon pote ! Vas-y, prends mon nom, tape-toi ma copine, j’ai du boulot pour toi aussi si tu veux ! Tsss… On a beau être prêt à tout avec une fille comme Constance, et savoir qu’on n’est pas amoureux, et accepter le fait que l’un comme l’autre, nous voulions rester libres avant tout, il y a des moments où l’on préférerait enfin une relation stable, avec une femme un peu normale, qu’on aimerait et dont on serait aimé. A mon tour, par honnêteté et pas mal aussi parce que j’étais blessé dans mon amour-propre, je lui ai avoué le coup de l’autre fille, sans toutefois trop rentrer dans les détails ; et tout en parlant je nous trouvais pitoyables, tous les deux à nous déballer nos infidélités comme de banals souvenirs de vacances. Il n’y avait aucune animosité, aucune tension entre nous, rien à voir avec un règlement de compte ni même une explication entre couple, puisque ça n’arrivera jamais entre nous, puisque notre liaison est insipide et triste, vaine, vide de sens ; et moi, avec ma part de tarte à la con, j’ai ressenti comme si souvent en ce moment l’envie d’envoyer tout balader, et de recommencer autre chose, enfin, ailleurs, en mieux.
Alors je crois que j’ai envie de déménager. Enfin, plus exactement, d’opérer une translation vers un autre arrondissement, n’importe lequel. Quoique non, pas le seizième. Ni le quinzième, ou même le septième ; bon, d’accord, pas n’importe quel arrondissement. Mais quitter mon quartier, ma rue Monge, au moins j’arrêterais de fantasmer sur toutes les étudiantes de Censier. J’ai déjà des vues sur d’autres appartements… D’autre part, j’en ai assez de mon travail, qui est beaucoup plus routinier qu’il n’en a l’air. A moins que ce ne soit pareil partout ? Et d’ailleurs, que pourrais-je bien faire d’autre ? Je me pose aussi des questions sur Constance, bien entendu, que je n’ai certes pas envie de perdre mais que n’aurai jamais totalement non plus. J’aimerais, enfin, apprendre à mieux réguler les notes de ce journal, et plutôt que d’écrire tous les jours comme un acharné pour finalement n’en publier que le dizième, m’attacher à rédiger un ou deux billets par semaine, à horaires relativement fixes. Et puis cesser de tout lire, partout, pour rien. Ca me fatigue. Voilà, on y arrive : je suis fatigué. Lassé de ne rien faire, et de ne jamais aller nulle part, ne jamais rien construire. Ca chauffait dans ma tête, cette nuit aux côtés de Constance ; elle dormait tout son saoul et moi je ruminais. J’ai fini par m’endormir vers quatre heures, tout plein du désir de changement, de projets, d’avenir.
Et comme par ironie, comme pour me rappeler que malgré ma volonté d’aller toujours de l’avant, tout me pousse décidément à tourner en rond, à revenir sans cesse en arrière, j’ai rêvé dans la nuit, pour la seconde fois cette semaine, que Sidonie m’embrassait. Ca a beau être ridicule, j’ai encore maintenant, deux jours plus tard, la mauvaise humeur bien nouée dans la gorge, dans les yeux et dans le cœur. Alors ces grandes résolutions, ces changements radicaux, ce sera peut-être pour l'année prochaine, ou pour janvier, tiens. C'est à ce moment qu'on fait des bilans, et non pas à la fin des grandes vacances. Je l'ai toujours dit : il n'y a que des niaiseries dans Voici.
02:10 | Lien permanent | Commentaires (56)
dimanche, 20 août 2006
quarante-quatre (alphabets éphémères)
Curieuse impression que de parcourir un blog laissé à l'abandon. Les mots gigotent encore un peu, et parviennent même, malgré le temps passé dans l'ombre, à tenir leur rôle, à faire rire, à émouvoir parfois, mais sans jamais sortir les textes et le journal tout entier d'une sorte de torpeur de fin de vie. On se sent un peu seul, dans les allées vides de ce journal, on n'ose pas trop faire de bruit de peur de déranger, de réveiller tous ceux qui dorment là. Ces visiteurs qui ont un jour couché leur nom et laissé leurs mots et s'en sont allés depuis, vers des contrées plus chaudes, plus ensoleillées, plus vivantes. On raconte parfois en avoir croisé l'un ou l'autre, sous une nouvelle identité, sur les pages de celui-ci, de celle-là. Mais tout ça, on n'a pas été vérifier, n'est-ce pas ? Tout ce qu'on sait, l'unique chose dont on soit sûr, c'est qu'on ne croisera plus personne sur ce journal, qu'on est désormais seul à en lire les articles, à en creuser les idées, là, dans sa tête, et qu'il n'y a plus que soi pour supporter les souvenirs brusquement réveillés et les émotions jusqu'ici tapies, cachées, qui tous ensemble vont tombent brusquement sur les épaules.
Mais ce n’était qu’un éboulement, le plafond ne tient plus, commence à s’écrouler ; on a eu tort de s’aventurer dans cette nécropole ; partons ! partons vite.
J'ai relu un jour l'imposante correspondance que j'avais entretenu, plus jeune, avec cette fille, (…) ; j'ai relu du moins les lettres qui venaient d'elle. Nous avions seize ans et si je n'avais pas peur du ridicule, je dirais que c'est la seule dont j'aie véritablement été amoureux, et même l’unique personne que j’aie jamais aimé, mais alors furieusement, passionnément, absolument, comme ça n'arrive qu'une fois par vie, par siècle, amoureux à s'en crever les yeux, à s'en ouvrir le coeur, à s'en immoler sans hésitation, sans concession. Ces pages noircies avec le sang, avec l'âme, la fougue au front et la folie aux aguets, ces textes arrachés à l'essence même de l'être, ces mots qu'on croyait alors plus symboliques et puissants qu'aucun autre, ils n'étaient plus rien que de longues et vaines arabesques courant sur le grain du papier, de longs sillons hachés, nerveux, qui tranchaient les pages en en soulignant le vide des sens d’une manière bien cruelle. Quinze ans auparavant c’était un cœur qui battait, mais le cardiogramme est plat désormais. A-t-on changé, en mieux, en pire, était-on stupide à l’époque ou bien l’est-on devenu aujourd’hui, cela n’a pas d’importance ; tout ce qui compte, c’est de comprendre que l’émotion s’est délavée comme l’encre de ces lettres, enfuie, évaporée, et qu’on se retrouve une fois de plus, face à son gros paquet d’enveloppes, avec une pesante impression de solitude, doublée cette fois du sentiment de s’être sacrément fait berner par la vie.
Les mots ne comptent pour rien.
Dans quelques temps, l’année prochaine, par exemple, en février, ou en mai, ou demain, qui sait ? il en sera sans doute de même pour ce journal. Les araignées, au plafond, auront fini par tisser leur toile entre des notes de plus en plus espacées et de moins en moins visitées. La poussière recouvrira le sens des mots pour ne plus laisser visible que leur forme, que leur dessin, et on y sentira, sur ces pages, comme une âcre odeur de renfermé, comme l’odeur de sale, de vieux, qu’on découvre en ouvrant les portes d’une centenaire maison désertée depuis belle lurette. Un voyageur égaré s’y reposera un moment avec, au fond de lui, comme un inhabituel semblant de curiosité d’abord, de nostalgie ensuite ; il verra les dates, mercredi, 24 mai 2006, dimanche, 20 août 2006, il verra les jours et pensera, seigneur, quel âge avais-je, que faisais-je le 20 août 2006 ? Le petit dernier n’était pas encore né… Quel temps faisait-il alors ? La guerre était-elle finie ? ou bien ne faisait-elle que commencer ? Et moi, qu’écrivais-je ce jour-là ? Voilà ce qu’il se dira, notre unique visiteur, voilà les seules pensées qu’il aura, et à aucun moment il ne songera à lire les notes, trop vieilles, trop longues aussi, trop lointaines évidemment. Parce qu’il est trop dur de lire les mots de ceux qu’on ne connaît pas, de ceux à qui l’on ne ressemble pas. Impossible de les aimer, de les comprendre. On refuse de faire l’effort. Et à vrai dire, on s’en fiche.
Partons, vite.
Les mots ne comptent pour rien, ils ne servent à rien puisqu’on ne les comprend pas. Comment, avec eux, exprimer ce que je pense ? ce que je suis ? Comment écrire, comment décrire une fois pour toutes ce qui se passe en moi, et que j’essaie d’observer, d’analyser tant bien que mal, depuis toutes ces années ? Mes mots m’aideront-ils à savoir qui les écrit ? Comment le croire ? comment leur faire confiance quand on sait que personne ne les lit de la même manière, et que même selon les humeurs, les jours, le temps qui passe, leur portée change radicalement… Le mot c’est, intrinsèquement, un mensonge éhonté : on nous fait croire qu’il transmet une information, alors que ce n’est qu’un point de vue soumis à interprétation. Un misérable outil dont on aurait perdu le mode d’emploi. Quand je pense qu’on a construit dessus toute l’histoire de l’humanité, je ne m’étonne plus de voir que tout le monde se tape sur la gueule… Affirmer que l’histoire de l’Homme commence avec l’écriture, c’est allumer les guerres !
Tout ceci ne compte pour rien, en fin de compte. On passe du temps à travailler ses billets, on se creuse à les écrire de manière simple et précise, claire et compréhensible, pour soi d’abord, et pour les autres ; on les voudrait sensés, ses propos, alors on y réfléchit mille et mille fois, on s’y perd, on s’y noie, et changer un mot au dernier moment, modifier la place d’une virgule, recommencer une phrase qu’on trouvait ambiguë n’y changera rien. Et le lendemain tout disparaît, ou plutôt, tout apparaît, mais sous un autre jour, rien de ce qu’on a voulu dire ne se retrouve sur l’écran, et l’étape qu’on pensait avoir franchi sur soi-même, il faudra recommencer à la courir, encore et encore, jusqu’à temps qu’on n’en puisse plus, et qu’on abandonne enfin son journal à l’érosion des éléments.
05:00 | Lien permanent | Commentaires (50)

