« 2006-08 | Page d'accueil
| 2006-10 »
dimanche, 24 septembre 2006
quarante-neuf (les fausses routes)
C’est dommage, la journée avait vraiment bien commencé. Après une très bonne soirée hier (ah, mais toute la journée de vendredi fut bonne, j’ai bouclé un travail en moins de temps qu’il n’en faut pour le taper sur le clavier) et une excellente nuit passée à cuver vaillament mon vin, j’ai été réveillé par les chauds rayons de soleil qui baignaient la capitale. Je me suis levé, l’esprit vierge de tout programme, à part celui de rentrer chez moi prendre une douche et manger un morceau - oui, j’ai dormi ailleurs, mais seul, n’est-ce pas. Croque-monsieur parfaitement réussi, accompagné d’une verte et fraîche salade. C’est que j’ai décidé de manger équilibré et de tenter de perdre les deux insupportables kilos qui se sont tranquillement installés, vermines, parasites, lors de mon inactivité estivale. Afin de retrouver mon corps d’athlète de seconde zone, la quantité, pantagruélique certes, de fromage que j’ai l’habitude d’enfourner entre les tranches de pain et de jambon s’est ainsi tragiquement vue réduite à la portion congrue. Tiens, je pense à l’instant que je n’ai plus de balance, puisque je me servais de celle de Constance et que la petite nous a quitté jeudi dernier pour sa province nouvelle. Plus de maîtresse ni de balance, il va falloir chercher ailleurs la motivation pour maigrir.
J’avais d’ailleurs pris rendez-vous par la suite à 17h30 devant l’Opéra Garnier, et je pensais y aller à pieds ; au bout de dix minutes de marche, je me suis engouffré avec bonheur dans une bouche de métro. Bref, c’est pas gagné... En sortant, je suis par malchance tombé en plein milieu d’une manifestation aux motivations pas très claires. En gros, il y avait des drapeaux du Liban et de la Syrie, des barbus, des femmes voilées, mais aussi des formations « gays et lesbiennes contre la guerre », des bobos à poussettes descendus de Montmartre, des bannières en Hébreu, et bien sûr la cohorte habituelle des pique-revendications, ceux qui mangent à tous les râteliers manifestants du moment que ça gueule bien, que ça peut cracher par-terre et sur les flics, verbalement du moins, en toute impunité, et que ça croit faire la révolution prolétarienne : j’ai nommé les marxistes-léninistes, les drapeaux noirs, la CNT, j’en passe et des meilleures. Ici et là, des portraits des leaders terroristes moyen-orientaux, exactement ceux qu’on ne croyait pouvoir apercevoir qu’à la télévision, le soir vers vingt heures. Un moment, une femme qui aurait pu être ma boulangère s’est mise à hurler « vive le Hezbollah » comme une harpie dont on déchire les entrailles. Une drôle d’impression. Plus loin, une sorte de camionnette aménagée en tribune s’est installée devant l’Opéra : s’y succédaient plusieurs personnages discourant dans un micro, et se contredisant bien involontairement les uns les autres, quand ce n’était pas le même orateur qui disait oui en disant non. Ca m’a rappelé le mea culpa de Zidane en juillet dernier, qui affirmait regretter son geste malheureux contre Materrazzi mais qui, ça va de soi, n’aurait rien changé si c’était à refaire. Merci Zinedine, t’as tout bon. Mais le plus curieux dans cette histoire de manifestation, c’est que j’ai eu beau demander à tous les acteurs du drame, du simple porteur de drapeau au barbu le plus farouche, en passant par le policeman au coin de la rue, à bonne distance, personne n’a su m’informer sur les tenants et les aboutissants de l’événement. On en restera là, quoi que je serais curieux de savoir ce que vont en rapporter nos amis les médias.
Comment j’ai pu retrouver, dans cette inextricable cohue, les deux personnes avec qui j’avais pris rendez-vous, demeure un épais mystère. Toujours est-il que nous avons fui au plus vite, et que pour changer radicalement l’ambiance, nous avons filé au Ritz, à deux pas. On aurait pas pu trouver mieux. Un endroit qui, quoi qu’on en pense, ne fait pas de discrimination, c’est bien le vénérable établissement. Malgré ses ors, ses tapis rouges, sa porte tournante et son personnel tiré à quatre épingles, on peut y rentrer sans problème, ni remarque, ni le moindre regard de travers, aussi mal rasé que je l’étais aujourd’hui - et en baskets pourries, encore. En fait, sa sélection, le Ritz ne la fait que par l’argent. Quelle révélation, n’est-ce pas. Bon enfin moi personnellement je m’en cogne, puisqu’on avait l’amabilité de m’inviter, et qu’on est plus riche que moi de quelques millions. J’avais donc le droit de prendre place dans le jardin de derrière, fort agréable ma foi, d’où s’élançaient quelques notes de harpes – comment ça une vraie harpiste, bien évidemment - qui semblait régler délicatement le ballet des serveurs ; et je dois d’ailleurs préciser que je n’étais pas celui qui dénotait le plus. On a pu distinguer deux jeunes Américaines en slim et Ray Ban, qui attaquaient rageusement leurs assiettes tout en hurlant dans leurs téléphones portables. Elles sont heureusement parties assez vite. Un peu à l’écart, il y avait un type en blazer bleu, couronne de cheveux, nez oriental, avec une gueule qui me disait quelque chose ; il sortait sa poule et lui faisait boire du champagne à six heures de l’après-midi. Quand on imagine seulement le prix de la bouteille (les plus chères atteignent les cinq mille euros, tout de même), on en viendrait presque à lui souhaiter qu’il fasse un bon investissement sur l’avenir. Je m’en souviendrai la prochaine fois que je devrai en mettre plein la vue à une fille, en espérant bien sûr qu’elle ne se mette pas à commander cinquante grammes de Beluga... En tout cas, naviguer entre deux mondes si différents, opposés, presque adversaires, qui se font face à cent mètres l’un de l’autre, ça fiche un drôle de mal de mer. Je ne connais ni l’un ni l’autre, je n’appartiens ni à l’un ni à l’autre et aucun ne pourrait me convenir ; je ne sais pas où aller et à vrai dire, je ne sais décidément pas où je vais.
Bon, je sors de là, le voiturier m’avance ma Bentley mais je vais préférer la marche. Ah, on me fait signe que non, la Bentley n’était pas pour moi ; ça tombe bien alors. Comme à l’allée, je finis le trajet en métro. A l’arrivée, il pleut. Il fait presque nuit. J’envisage de me faire un petit plat de sale perso, avec du vin et un film dans mon fauteuil, mais la nouveauté c’est que mon lecteur DVD ne marche plus. Pas envie de sortir ; du coup, ce billet se pond presque tout seul. Lui non plus n’était pas prévu. Ni réfléchi d’ailleurs, ni travaillé, ou encore de grande qualité. A propos, je crois que ce qui va se passer désormais sur ces pages, c’est qu’il s’y publiera de temps en temps une note écrite un soir d’ennui, de désoeuvrement, de solitude, ou plutôt un soir où je sentirais le besoin de taper sur un clavier ; parce que si j’écrivais à chaque moment de solitude, de désoeuvrement ou d’ennui, on ne serait pas sorti de l’auberge. Peut-être sera-ce toutes les semaines, ou deux fois par mois, ou moins encore. Je tente cette méthode, puisque celle de l’effort et du labeur n’a pas été payante sur le long terme, à mon grand regret. Et oui, c’est comme un forfait qu’on déclare. Un aveu de faiblesse, en somme. C’est difficile de ne jamais réussir à choisir ses qualités. Celles grâces auxquelles on décide de se construire. Je me rêve en homme fort et tenace, stoïque, je m’efforce à toujours réfléchir, prendre du recul, mettre en balance, je me lance dans de vains combats, contre les kilos superflus par exemple, et je finis comme toujours par me vautrer dans la facilité, l’accessible, le connu. Mais le vrai luxe, c’est ça : la tranquillité. Qu’il s’agisse de payer vingt-cinq euros son mojito pour échapper aux réalités d’un monde qui gronde juste derrière la porte tournante, ou se soustraire à ses obligations de réflection, d’analyse, parce qu’on est paresseux, qu’on préfère se saborder que de continuer, on en revient toujours au même souhait : celui de ne pas être dérangé.
Je me demande si j’ai déjà, au cours de ma trentenaire existence, fait le moindre choix, ou si au contraire tout ne s’est pas imposé à moi parce que je suis paresseux et que je prends toujours la voie la plus praticable, la moins fatigante, la moins dangereuse. Tu parles d’un luxe. Les choses viennent à moi, ou pas, amis de circonstance, rencontrés par hasard et accompagnés par concordance des temps plus que des sentiments, carrière aléatoire qui s’est décidée toute seule et souvent contre mon gré, femmes auxquelles je m’attache parce qu’elles ne me rejettent pas, et jusqu’à cette note écrite parce que mon lecteur DVD a rendu l’âme. J’ai beau dire je, j’ai beau dire moi, c’est parfois à se demander s’il n’y a pas quelqu’un derrière qui tient la plume à ma place.
03:00 | Lien permanent | Commentaires (18)
mercredi, 13 septembre 2006
quarante-huit (en pleine tête)
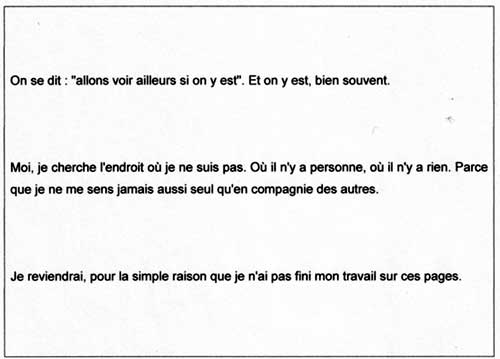
16:35 | Lien permanent | Commentaires (23)
mercredi, 06 septembre 2006
quarante-sept (le bonheur pour 100 millions de dollars)
On a beau tenter de se limiter à des plaisirs simples, accessibles, raisonnables, on a beau se forcer à être fataliste, et accepter la médiocrité, et se résoudre à un sort pourtant peu enviable, on en veut finalement toujours plus, ou mieux, ou différent : c’est ainsi. Sans vouloir généraliser et aller jusqu’à parler de propre de l’Homme, il est facile de constater que ce sentiment absurde reste étranger à nos chers amis les animaux : un chat qui mange en une fois la totalité de ses croquettes, en vidant sa gamelle avant de trouver la réserve et d’y tout rafler, ça s’est vu, mais c’est rare. Et puis ce n’est, selon moi, qu'une dégénérescence due au voisinage des bipèdes - en général, une fois rassasiées, les bêtes ne pêchent pas par gourmandise. A part ces cupides écureuils, ou cette insupportable moraliste de fourmi, elles ne cherchent jamais à amasser, qu’il s’agisse de nourriture, de territoire, ou de conquêtes sexuelles. Mais quand moi, qui ne suis qu’un homme, je cherche tranquillement, modestement, petitement, des recharges de polaroïd sur un célèbre site d’enchères en ligne dont le nom commence par « e » et finit par « bay », je tombe d’abord sur un super appareil bien plus élaboré que le mien, qui me fait instantanément envie, et j’ai ensuite le malheur de découvrir les autres objets du vendeur… Entre un « circuit Hornby » (mais qu’est-ce que c’est que ce truc ?) à mille euros tout de même, et un « moulin à poivre géant » (!) à trente-cinq, ceci :

Tête de jeune fille à la frange, Modigliani. Alors c’est simple, il me la faut. 13 500 euros, ça se trouve facilement, non ? Non ? Même si j’ai déjà un apport de disons… mille euros ? Toujours pas. Même à la banque – surtout à la banque. Bon. Je pourrais contacter un organisme de crédit, en six minutes j’aurais ma réponse, paraît-il. Mais il semblerait également que ce genre de privilège fallacieux ne soit accordé qu’à une clientèle déjà largement surendettée désireuse d’acheter des home cinémas. Un coup marketing, je crois que ça s’appelle. Une sorte d’alliance des puissants, mais allez, je m’égare. Vendre un truc en échange, alors ? Oui, un truc de valeur. Genre ce que j’ai de plus précieux. (Rapide tour d’horizon de mon environnement.) Je pourrais déjà tirer près de 250 euros de mon ordinateur. Mazette ! Et 25 euros de mon scanner - peut-être trente. Ah ! j’avais pas regardé dans mon placard : on peut rajouter deux costumes et deux paires de groles de marque italienne. Grandes marques italiennes. Enfin il faudrait assumer d’aller à mes rendez-vous, certes peu nombreux en ce moment mais raison de plus, en jean et en basket. Après… Vendre des livres (de poche) ? des disques (gravés) ? Mon corps (...) ? A la rue, ou même à la science ? J’y ai pensé ! Mais je ne suis pas sûr que ce que j’en tirerais en vaudra la peine.
Sans rire, je me suis toujours dit que quand je serai grand, et riche, et enfin posé, je m’achèterais une toile de maître à placer au-dessus de ma cheminée, dans mon salon ou dans ma chambre. Un Bruegel, par exemple - l’Ancien, oui. Un Ucello, que j'aurais acheté au Louvre. Un Picasso, ou un autre, ou bien celui-ci. Ou encore Chagall, Raphaël, Bosch. Je le contemplerais longuement, mon chef-d’oeuvre, en silence, sans être capable de ne rien faire, et je me dirais que ma vie a eu un sens puisqu’elle m’aura offert de me repaître les yeux de ces merveilles. Parce que je crois que je ne pourrais jamais m’en rassasier. Jamais m’en lasser. Parce que jamais je ne pourrais désirer plus, ou mieux, ou différent, et parce que plus, ou mieux, ou différent ça n’existera plus. On comprend ce que signifie l’échec des mots, et j’irai même jusqu’à dire, de l’image animée, finie, face à ces visions pérennes et plus mouvantes qu’il n’y paraît. Combien d’interprétations pour un seul coup de pinceau ? Quels sont les mondes inexplorés qui s’ouvrent au creux de ces couleurs et de ces courbes ? Combien d’heures de lecture, combien de philosophies, de théories, de vers et de rimes, et ces mille histoires qu’on se laisse conter, et cet œil qui passe du bleu au vert, du jaune au rouge, et cette bouche qui parle une langue inconnue et ces corps alanguis qui n’expriment que les mystères et les puissances de l’univers… Qu’emporteriez-vous sur une île déserte ? Oh, trois fois rien, ma toile de maître et je pourrais mourir en paix.
Dès lors, deux stratégies de bonheur s’affrontent. D’abord, celle que j’ai décrite plus haut, dite des « plaisirs simples ». C’est l’amour raisonnable que j’évoquais dernièrement, qui consiste à se satisfaire de celle qu’on a trouvée là, sur sa route, qui a souri et proposé de continuer ensemble, parce qu’à deux c’est plus facile qu’à un. Pourquoi se poser des questions ? Elle est belle et pleine de qualités. Quant au sentiment amoureux, on verra bien s'il finit par venir. C’est, aussi, se contenter de son studio perché, sans confort mais avec tant de charme ! enfin ça c’est ce qu’on se dit. C’est accepter de ne pas évoluer dans son travail, depuis trop longtemps et peut-être pour toujours, mais se dire que c’est suffisant, que c’est très bien comme ça. De toute manière on n’a pas l’intention de nourrir qui que ce soit, à part son aigreur de petit vieux et sa misanthropie croissante. Ca fait quelques années que j’essaie de raisonner comme ça, en cherchant la voie de la sagesse. J’aimerais bien être sage, pas « sage comme une image », s’entend, mais réfléchi, sensé, avisé. Pas blasé, pas revenu de tout, mais avec le recul de l‘expérience, pouvoir se dire : je suis heureux malgré tout. Ce sont des qualités qui m’ont souvent fait défaut mais que je crois qu’il est possible d’acquérir.
Et puis, il y a la stratégie qui consiste à chercher la qualité suprême dans le bonheur, à viser l’indépassable, le sublime, l’extase permanente, parce qu’autrement, comme je le disais, on est toujours tenté par la surenchère, et qu’avoir le meilleur est le seul moyen de ne pas rêver à mieux. Ne pas se contenter de la deuxième place dans la course à la vie, derrière son possible, derrière l’ombre de soi-même. L’argent ne fait pas le bonheur, mais l’or… Reste à savoir lequel de ces deux sentiers du bonheur rend finalement le plus malheureux : mais s’il est dur de se dire qu’on n’aura jamais, quoi de plus cruel que de penser qu’on aurait pu ? Bon, sur ce, j’y retourne : il ne me reste plus que trois jours pour trouver mes 13 500 euros.
16:00 | Lien permanent | Commentaires (43)

